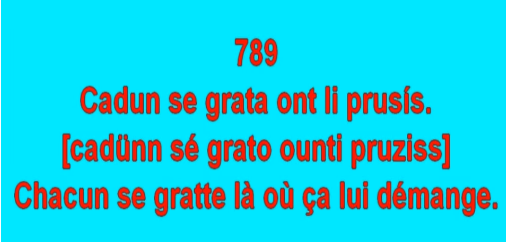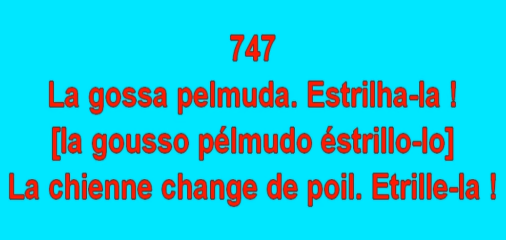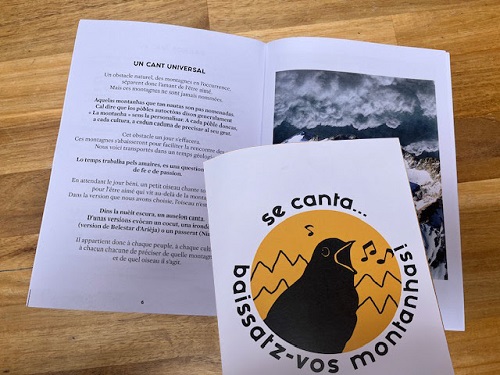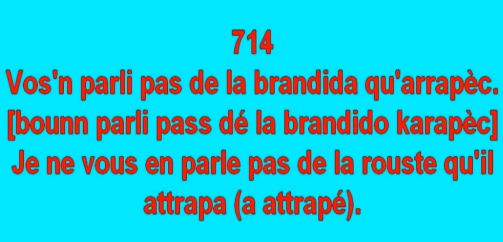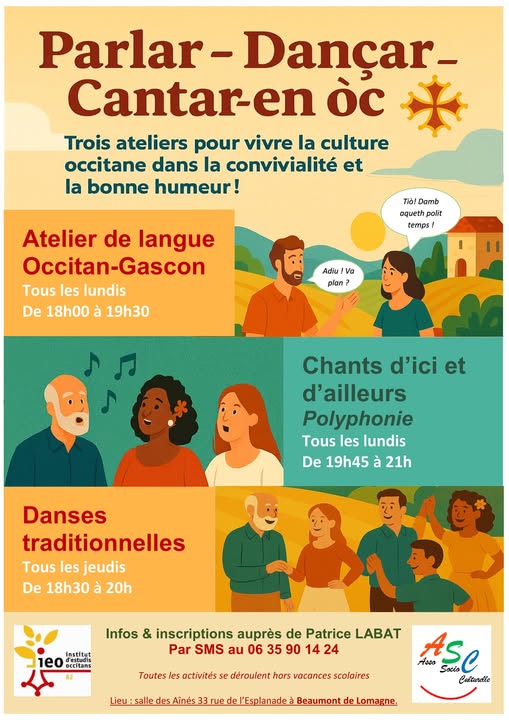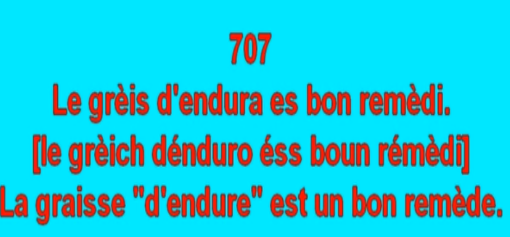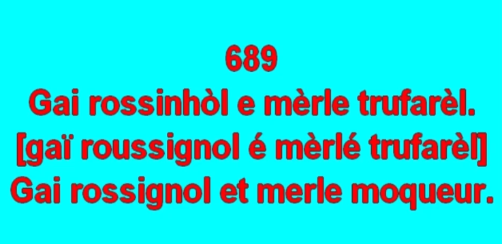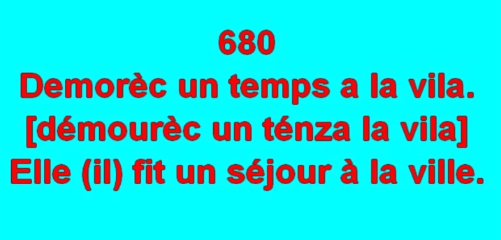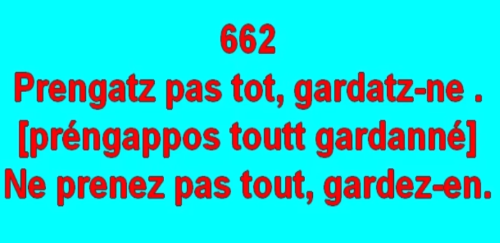Interview à Bram 2025 de Jean-Luc Davezac Bastir Occitanie
Interview réalisé par Alexandre Chiavassa de Vittorio de Radio Occitania lors des rencontres de Bram (11) organisé par Carole Delga et la municipalité de Bram.
Au sein de ce rassemblement de groupes progressistes, Bastir Occitanie et Régions Unies d’Europe, Occitanie Pais Nostre et Ecologie Autrement étaient représentés par Jean-Luc Davezac et Alexis Boudaud.
Les régionalistes et les écologistes pragmatiques ont réalisés des rencontres très positives pour les prochaines actions sur le terrain.
Ces groupes espèrent que leurs rencontres susciterons une vraie décentralisation avec une évolution au sein du parti socialiste notamment.